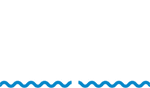Certains se souviennent des postes de péage aujourd’hui disparus sur les autoroutes ou à l’entrée des ponts Jacques-Cartier et Champlain. On oublie cependant que de 1840 à 1911, les habitants de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve devaient emprunter un poste de péage pour entrer à Montréal. La seule route carrossable entre Montréal et Québec était le Chemin du Roy aménagé en 1737. Les seigneurs devaient veiller à l’entretien de leur portion du chemin. Au début du 19e siècle, des voix s’élèvent pour que le gouvernement prenne en charge l’entretien de la route qui est dans un état de plus en plus lamentable. En 1840, le gouvernement vote la création du Montreal Turnpike Trust (plus tard le Syndicat des chemins à barrière) qui se financera par l’imposition d’un péage sur toutes les routes autour de l’île. Le montant du péage dépend du nombre de roues et de chevaux. L’imposition de péages est très impopulaire et nombreux sont ceux qui vont chercher à contourner cet obstacle.
On aménage la future rue Notre-Dame légèrement au nord du Chemin du Roy, l’érosion ayant fait déjà des ravages. Le premier poste de péage de l’arrondissement est à la hauteur de la rue Frontenac. Lorsque la ville de Maisonneuve est créée en 1883, la barrière est déplacée à l'avenue Valois. En 1889, la ville de Maisonneuve paie des redevances au syndicat et la barrière est installée à Longue-Pointe au ruisseau Molson. Une autre barrière s’ajoutera au niveau de la rue Caty (expropriée en 1999) au moment de la création du village de Beaurivage. En 1906, la barrière de Viauville rapporte 4921 $ et celle de Longue-Pointe, 1728 $. C’est la fin des péages en 1911 lorsque Montréal paiera à son tour des redevances. En 1922, le gouvernement confie la responsabilité des routes au ministère de la Voirie et aux municipalités.
Image : Musée des Beaux-Arts du Canada. La barrière à péage, par Cornelius Krieghoff, 1861