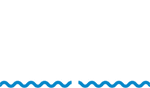Au début de l’année 1917, un mouvement est lancé dans les villes du Canada pour transformer les terrains vagues en jardins potagers. Ce seront les « Jardins de guerre ». L’inquiétude monte devant la possibilité de famine en Angleterre et dans la France occupée. Il faut s’assurer également que les exportations agricoles vers l’Europe demeurent constantes et puissent augmenter sans affecter les approvisionnements canadiens. À Montréal, le mouvement est porté par le Montreal Cultivation Committee. La récolte des produits de 2 000 jardins à Montréal est évaluée à 100 000 $. En avril 1918, l’Association des jardins de guerre est créée à Montréal sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le gouvernement du Québec y mettra des ressources et du personnel. Des écoles sont associées à ce projet comme l’école Boucher-de-la-Bruère, rue de Lavaltrie, dans Mercier. En 1918, ce seront 20 000 jardins sur l’île (dont la moitié à Montréal) qui donneront une récolte évaluée à 1 000 000 $. Cette même année, la chanson « Les petits jardins de guerre » connaissait une belle popularité.
La photo de La Presse, parue dans l’édition du 24 juin 1918, montre l’immense jardin de guerre couvrant le nord et l’ouest de l’ancienne école Boucher-de-la-Bruère. On y voit distinctement la rue Lepailleur au premier plan, puis les rues Charlemagne (Curatteau) et de Boucherville. On distingue également la rue de Lavaltrie à gauche. À droite, on aperçoit les maisons du 1686-88 et du 1696, rue Lepailleur. Au fond à gauche, rue de Boucherville, se trouve la résidence des Sœurs de la Providence puis des bâtiments de ferme des religieuses. Enfin, à l’extrême droite, on devine les bâtiments principaux de l’Asile St-Jean-de-Dieu. On peut se permettre de penser que les jardins se rendaient au moins jusqu’à l’actuelle rue Ontario et peut-être jusqu’à la rue Hochelaga.
Image : BANQ, fonds La Presse, Jardins de guerre de Mercier-Est; photo parue le 24 juin 1918.
.jpg)