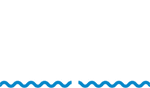Au début de l’année 1928, l’Hôpital du Cancer de Montréal situé 3663-3673 Adam fait la une des journaux. Pierre-Joseph Champagne, Lozéphire Marcoux et Marcel Daigneault de l’Hôpital sont tenus criminellement responsables de la mort de Wilfrid Clermont qui était venu y faire soigner un cancer de la gorge.
Dans le cadre du procès, Sir Henry Gray - un éminent chirurgien écossais - présente un rapport accablant de la situation. À la suite de la visite de l’hôpital de la rue Adam, il conclut que cette institution profite de l’ignorance et de la crédulité des gens.
Ce constat n’est pas très étonnant. Quelques années auparavant, Lozéphire Marcoux avait été condamné pour exercice illégal de la médecine et, en juillet 1927, Marcel Daigneault s’était vu retirer son droit de pratique pour une période de deux ans par le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec. L’enquête révèle également que Béatrice Dagenais employée comme infirmière (appelée à l’époque garde-malade) ne possédait pas de diplôme ni n’avait fait d’étude de garde-malade.
Sir Henry Gray explique que le traitement offert par l’hôpital est en contradiction avec ce qui est connu du traitement du cancer. Ce dernier consiste dans l’application externe d’un emplâtre - l’emplâtre Marcoux - qui une fois retirée du patient devait enlever par la même occasion le cancer. De plus, pour une raison inconnue, les patients ne devaient pas toucher l’eau durant leur traitement. À l’époque, les seuls traitements efficaces contre le cancer sont des chirurgies très agressives ou des radiations obtenues à l’aide de radium. D’ailleurs, en novembre 1926, l’Institut du radium de Montréal s'installe à Maisonneuve dans ce qui est aujourd’hui la Bibliothèque de Maisonneuve.
L’Hôpital du Cancer de Montréal était un hôpital privé à but lucratif. Presque complètement disparu au début des années 1980, ce type d’hôpital se développe au Québec comme au Canada ou aux États-Unis dans les dernières décennies du 19e siècle. Assez peu étudié au Québec, selon les historien.ne.s Aline Charles et François Guérard, ce type d’institution forme une mosaïque très diversifiée tant en termes de créneaux que de clientèles et de gestionnaires. Dans le cas de l’Hôpital du cancer, nul doute que l’on se trouve devant la forme la moins reluisante d’une telle institution.
Auteur : Olivier Dufresne
Image : L’Hôpital du cancer de Montréal qui portait le numéro 2417 de la rue Adam au moment de son existence. AHMHM, fonds Famille Champagne